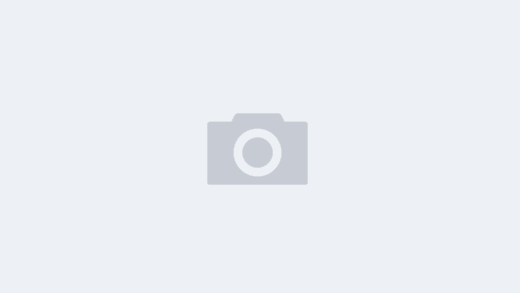En 2025, l’Ukraine a accéléré l’utilisation des drones pour frapper des objectifs stratégiques en territoire russe. Ces attaques, de plus en plus fréquentes, visent des infrastructures considérées comme essentielles pour l’effort de guerre russe : centres industriels, dépôts de carburant, raffineries et sites militaires sont régulièrement ciblés.
La raffinerie de Ryazan a été l’une des cibles majeures. Le sinistre déclenché par la frappe a paralysé temporairement l’activité du site. Ce genre d’opération réduit la capacité de la Russie à soutenir son armée sur le terrain, notamment en matière d’approvisionnement en carburant. Une autre attaque a visé une usine chimique dans la région de Moscou, entraînant un ralentissement de sa production.
Les drones utilisés par les forces ukrainiennes proviennent de sources variées. Certains sont conçus localement, d’autres sont dérivés de modèles civils, adaptés aux besoins militaires. Plusieurs engins ont été fournis par des partenaires étrangers. Leur autonomie est élevée, parfois supérieure à 800 kilomètres. Volant à basse altitude, ils passent souvent sous les radars. Leur capacité explosive reste limitée, mais suffisante pour endommager les cibles peu protégées.
Une opération marquante, surnommée « Spider’s Web », a eu lieu en juin 2025. Plusieurs drones ont été lancés en même temps vers différentes régions : Briansk, Toula et Lipetsk. Les frappes ont touché des installations industrielles et provoqué des incendies. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont confirmé l’étendue des dégâts. Le gouvernement russe a reconnu que plusieurs infrastructures avaient été sérieusement atteintes.
Ces frappes perturbent fortement la logistique militaire russe. Le ravitaillement, le transport des munitions et l’organisation des lignes d’approvisionnement sont affectés. De plus, elles obligent Moscou à renforcer la défense de sites situés loin des zones de combat. Cela implique de disperser des équipements antiaériens sur un territoire plus vaste.
La Russie a mis en place plusieurs réponses techniques. Des systèmes de brouillage sont installés pour perturber la navigation des drones. Des défenses antiaériennes à courte portée ont été redéployées. Des solutions expérimentales, comme des armes laser ou des dispositifs de capture, sont également à l’essai. Néanmoins, ces moyens restent partiellement efficaces, surtout face à des frappes multiples ou de nuit.
Pour l’Ukraine, la stratégie repose sur la production rapide de drones simples et peu coûteux. La fabrication est dispersée sur plusieurs lieux pour éviter qu’un seul site ne soit visé par des frappes russes. L’aide de plusieurs pays européens permet aussi de se procurer des éléments de haute précision.
Ce type de guerre marque une transformation des méthodes de combat. Les drones permettent d’agir loin du front, sans engager directement des unités humaines. Ils modifient les équilibres traditionnels et imposent de nouveaux réflexes tactiques. Les enseignements tirés de ce conflit influenceront sans doute d’autres armées dans les années à venir.
Ces frappes ont aussi une portée symbolique. Elles rappellent à la population russe que la guerre n’est pas confinée aux régions frontalières. Cette réalité crée un sentiment d’insécurité dans des zones jusque-là préservées. La pression sociale et politique sur le gouvernement s’en trouve renforcée.
Enfin, la multiplication de ces frappes soulève des débats sur les règles juridiques en vigueur. La nature des drones utilisés, la difficulté d’attribuer précisément chaque opération, et les conséquences sur des infrastructures civiles posent des problèmes complexes pour le droit international. Ce contexte pourrait entraîner une évolution du cadre légal entourant l’usage militaire des drones.